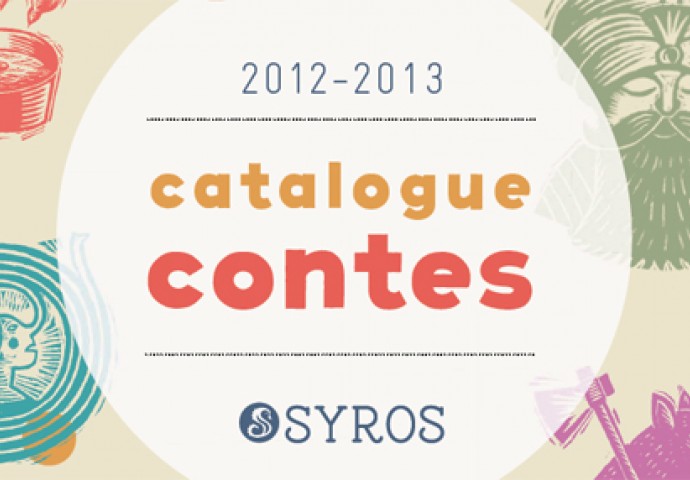
Comprendre, aimer, défendre le conte ! # épisode 7
Le conte populaire est l’un des genres narratifs de la littérature orale, car il obéit à des règles stylistiques qui relèvent de la littérature ; rimes, assonances, métaphores, poésie, musicalité. La langue du conte est particulière, voici quelques-unes de ses caractéristiques.
Les sésames du conte
Dans toutes les langues connues, une formule d’ouverture et une formule de clôture encadrent le récit. En français, nous connaissons « Il était une fois », en arabe, « Il était ou il n’était pas », en anglais, « Once upon a time », qui sont le sésame des contes. Ces formules souvent rimées et rythmées constituent un sas entre la réalité et la fiction, un passage vers un autre espace et un autre temps où tout est possible, mais aussi vers un registre langagier symbolique et poétique. Quand le récit est terminé, les formules de clôture viennent marquer le retour à la réalité. Le conteur ramène son auditoire à bon port, ici et maintenant. Aux Antilles, ce passage est très clairement exprimé : « Et j’étais là-bas, j’ai rencontré [un personnage du conte], je lui ai demandé pourquoi [il a fait ce qu’il a fait], et il m’a donné un coup de pied qui m’a fait traverser le ciel, et je viens de tomber ici pour vous raconter mon histoire. »
Un style concis, une langue précise
La concision est l’une des principales caractéristiques du conte. Il n’y est jamais question de psychologie, d’intentions ou de descriptions qui ne sont pas absolument indispensables à la dramaturgie. « Il était une fois un roi qui avait trois filles, la troisième était belle comme le coeur du matin. » Ce début de conte, concis, nous donne de nombreuses informations. Il nous apprend qu’il s’agit d’un conte merveilleux dont la petite dernière est l’héroïne et que nous passons à une langue poétique. Il faut souligner que l’héroïne n’est jamais décrite avec plus de précision, afin que chacun puisse s’identifier à elle. La langue précise du conte donne surtout à voir des images. Le récit se déroule ainsi comme un film dont la dramaturgie limpide emmène l’auditeur-spectateur là où il doit être pour pouvoir suivre les événements essentiels de l’histoire. Tout ce qui ne fait pas image et qui n’aide pas l’histoire à avancer relève du commentaire et n’a donc pas sa place. Raconter, c’est aligner des actions qui sont si fortes qu’elles parlent d’elles-mêmes des personnages. Nul besoin de qualifier de « méchante » la mère qui découpe son fils et qui le fait cuire dans une marmite.
Formulettes et répétitions
Les formulettes font partie intégrante du style propre aux contes. Elles marquent souvent le temps qui passe ou la longue distance parcourue par un personnage. « Marche aujourd’hui, marche demain, à force de marcher, on fait du chemin », « Dans la vie, il faut des années, dans les contes, il suffit de deux mots, voici les enfants devenus grands », « Elles avaient pour seul lit la terre et pour seule couverture le ciel. Elles ont marché longtemps, des mois et des ans, une ville les prenait, une ville les posait », etc. Certaines prennent la forme de comptines, « Turbot, Turbot dans la mer, Croix de bois et croix de fer, Y a ma femme Elsabella, Qui veut autrement que moi ». Elles reviennent plusieurs fois dans le cours du récit. La répétition d’une action2 produit le même effet : « Il a marché, marché, marché », pour marquer la distance et la durée. Les événements se répètent aussi, souvent trois fois. Dans les contes merveilleux, les deux aîné(e)s suivent un parcours où ils (elles) échouent. Le héros ou l’héroïne, en général les cadets, suivent le même parcours et réussissent. Les héros des contes merveilleux peuvent aussi faire trois rencontres, entreprendre trois voyages, etc. Cette répétition structurelle donne un souffle particulier à la narration, une relation au temps du récit singulière et un rapport du corps du conteur à la durée de son histoire. Ainsi, avec son style propre, le conte est mis en musique et en corps par un conteur ou une conteuse, pour parvenir à un auditoire. Il est porté, vivant, comme une partition, avec ses silences, ses accélérations, ses nuances. Le transmettre par le biais de l’écrit nous impose de préserver, le mieux possible, son oralité.
De Praline Gay-Para : L'ogre gentleman, La femme dorade, Contes à jouer du chapeau, Les sept crins magiques
Pour suivre la conteuse : www.pralinegaypara.com